Extraits du livre de Richard Chartier
OXYGÈNE SANS BOUTEILLE
Géo Plein Air – Les Éditions La Presse
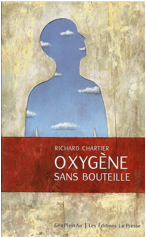
Pages 260 à 275
LE
FOND DU CIEL
22
DÉCEMBRE 2002. Il y a un bon moment
que nous progressons sur le sentier jonché des feuilles mortes de la mi-octobre.
La pente est juste parfaite pour nous mettre en jambes et nous tenons un rythme
modéré, sachant que la randonnée sera engageante.
À l'approche
de la zone alpine, un souffle venu des hauteurs râpe crûment la cime des
arbres et nous fait savoir qui est le boss ici.
Nous voyons enfin se dresser l'éperon rocheux - notre route - qui se perd dans
une purée grise et épeurante. À droite, à quelques
mètres, nous percevons nettement l'ambiance aérienne de King Ravine.
Il neige. À l'horizontale.
Une dernière halte avant la
tempête. «Nous y sommes dans dix minutes », annonce
Jean-Pierre. Chacun se caparaçonne pour l'attaque. Daniel et moi échangeons un
regard légèrement angoissé, Normand laisse sortir la vapeur de sa chemise
avant d'endosser des pelures et Marco, le cadet, trouve tout drôle.
Chacun se parle
intérieurement et je me demande si l'idée était si bonne d'accompagner cette
bande de cinglés.
Au-delà d'un petit panneau
de mise en garde sur les dangers et la fragilité de la zone alpine, nous
débouchons enfin dans la rocaille semée de bosquets. Comme à 2000 km plus au
nord, la végétation monte à la hauteur de nos chevilles; elle est constituée de
saules rabougris, de bouleaux nains et d'essences qui résistent mieux aux
brutalités de l'hiver qu'aux pas des marcheurs. Instantanément, nous nous
retrouvons au-delà de la limite des arbres. La furie des éléments nous agresse.
Entre le calme et la tempête, il n'y a pas un mètre. Il n'y a qu'un
pas.
La neige s'immisce partout.
Les roches enduites de glace n'accueillent plus nos pieds, elles les menacent.
Les bâtons de ski sont dès lors utiles. Il nous faut faire un effort pour
avancer sans nous faire balayer de côté.
Nous sommes pourtant encore
à quelques bonnes coudées de l'échine de pierre - nommée arête Durand - qui
grimpe dans le ciel, encore plus exposée aux quatre vents.
J'ai la chienne.
Ce n'est pas tant la force
du vent que ses changements de vitesse et de direction qui nous désarçonnent.
Il est clair que le vent
provient du ravin, ce qui est évidemment mieux que l'inverse, mais parfois une
bourrasque explosive nous pousse vers les dalles toutes proches qui plongent
dans quelque chose d'invisible qui doit s'appeler la paraplégie ou la mort.
«JP, je pense que ça devient
dangereux, on peut partir en l'air comme des plumes, tu le sais aussi bien que
moi. Je me réserve le privilège de virer de bord si je pense que ma vie est en
danger. »
C'est moi qui ai parlé, grande gueule.
Marco me regarde d'un air sincèrement étonné. Jean-Pierre émet un avis
compétent: «Jusqu'ici, ça va.
Si vraiment ça ne passe pas, on va faire marche arrière. »
Je connais Jean -Pierre
Danvoye depuis la première hivernale au K2, en 1987-1988. Le gars est un
athlète accompli doublé d'un montagnard rusé et il a séjourné sur des cimes à
plus de 8000 m. Il fait partie des quelques rares personnes que je suis prêt à
suivre avec confiance quand il s'agit de mettre un pied en enfer. Comme dans la
chanson de Petula, il veut aller au ciel- il y monte d'ailleurs à l'instant -,
mais il ne veut pas mourir. Et il sait comment.
«OK.»
Je ne dirai plus un mot sur
le danger, je marche en dehors de mon champ de compétence. Chacun se ramasse
et entreprend d'affronter le géant du mieux qu'il le peut. Les cristaux de
neige nous dardent les yeux, c'est insupportable. Je mets mes goggles et me rends compte, non sans
embarras, que je suis le seul à y avoir pensé.
JP' qui a aussi « oublié»
ses bâtons, et Marco ne semblent pas ennuyés outre mesure. Mais pour Daniel,
les yeux à découvert, et Normand, qui porte des verres d'ordonnance, je suis
désolé; ils ne l'auront pas facile.
Les compagnons
d'aujourd'hui, autant que nous sommes, avons en commun l'expérience d'avoir
fréquenté la haute montagne: Aconcagua, mont Blanc, K2. Cela ne nous empêche pas de tomber plusieurs fois sous la force des
éléments.
Nos conciliabules vont au
plus coupant, il faut être en voix pour se faire comprendre. Jean-Pierre se
tient à deux mains après le poteau et le panneau qui proclame «Air Line Trail
». Voilà un sentier qui porte bien son nom! Plus nous approchons du col des
monts Adams et Madison, plus nous sommes isolés, livrés à nous-mêmes. La visibilité
tombe à peu de chose, le GPS de Normand semble hésitant, un vent furieux
chargé de neige emporte la communication entre la petite machine qui tient
dans la main et les machines qui orbitent autour de la Terre.
Jean-Pierre, lui, n'hésite
pas. Dans sa tête, il a un «JPS », si vous permettez. Ce gars-là m'étonnera
toujours: vous pouvez lui bander les yeux et le trimbaler dans toutes les
directions pendant des heures, il vous indiquera le nord avant de recouvrer la vue.
À l'approche du col, Danvoye
s'en va les mains dans les poches, touriste impénitent. Des vents à écorner les
boeufs, il en a vu! Il estime la vitesse du vent à 80 km/h (on apprendra plus
tard qu'il souffle en réalité à 120-130 km/h, là mon JP t'es moins bon, mais je
te reconnais bien).
Jean-Pierre monte
complètement dans le col, il regarde à gauche et à droite, curieux, émerveillé,
il savoure cet instant de montagne comme s'il s'agissait d'un tableau dans un
musée. Pourquoi diable, derrière lui, suis-je obligé d'en faire des bouts
presque à quatre pattes?
«Bon, on s'en va à Crag Camp
», décide mon vieux compagnon d'aventure. Mais ni lui ni Marco ne sont vraiment
pressés.
«J'aime assister à l'instant
où ça se claire. » Et s'attarder dans
ce lieu effrayant où l'on voit tout le ciel, les nuages et le gros temps venus
de l'Atlantique nous entrer directement dedans. J'ai l'impression d'essayer de
tenir debout au fond d'un fleuve, j'ai du mal à respirer, moins à cause de la
pression qui diminue avec l'élévation qu'en raison d'une simple difficulté
mécanique.
Bien avant que ça se dégage
et pendant que Normand rengaine son GPS, mister Danvoye nous montre la route. «
C'est par là! » Le ciel redevenu
transparent, sans pourtant avoir perdu de sa vélocité, nous confirme la compétence
de notre guide.
Crag Camp surplombe King
Ravine dans le dernier bastion de la forêt. Ce n'est pas la première fois que
j'arrive ici en passant pour un fou. Le refuge est aussi gros qu'un bungalow et
comme il est tracassier d'accès, on n'y dépose pas des cordes de bois en
hélico, ce serait un peu trop fort. Crag Camp n'est donc pas chauffé. Un gars
et une fille qui n'ont pas osé mettre le nez dehors y grelottent patiemment et
nous regardent descendre du ciel comme si nous étions des extraterrestres.
Il ne nous reste plus guère
de glucose sous le polar et, ma foi, il fait quasiment plus froid (lire humide)
dedans que dehors!
Il faut bien venir en ce
lieu infernal - on décrit la Presidential Range comme la plus dangereuse des
petites montagnes - pour être obligé d'enfiler sa doudoune à l'intérieur. ..
Nous discutons de notre plan
original qui consistait à traverser jusqu'au mont Washington pour descendre
vers Pinkham Notch, ce qui serait un peu téméraire aujourd'hui. Nous
redescendrons plutôt vers le stationnement Appalachia, en bordure de la route
de Gorham.
Que nous atteindrons après
un (mémorable) séjour de neuf heures dans la montagne.
Ce sera l'heure d'aller en boire une bonne. Ou deux, si on n'a pas à
conduire ...
GOOD MORNING,
AFGHANISTAN!
22 SEPTEMBRE 2001. «Non, je ne suis pas Russe.
Non, je ne suis pas Américain. »
Quand on a la tête blonde et
les yeux bleus et qu'on fréquente les routes parfois dangereuses d'Asie
centrale, ces deux petites phrases suivies d'un souriant «je suis Canadien»
protègent mieux qu'un gilet pare-balles.
Mais elles nous auraient été
inutiles dans ce camp d'entraînement dont nous entendions les crépitements
d'artillerie, en bordure de la rivière Kunar. Précisément dans cette province
où la grande armée soviétique avait pour la première fois mis le genou à terre
et perdu la névralgique voie de communication entre le Tadjikistan et Jalalabad.
Dès lors obligée de fréquenter le Panjshir et ses cols coupe-gorge tenus par
Ahmed Shah Massoud, l'Armée rouge avait dû un an plus tard renoncer à occuper
l'Afghanis tan.
Peu de temps après, au cours
de l'été 1990, le - à l'époque - photographe Jean-Pierre Danvoye et moi avons
séjourné clandestinement en Afghanistan grâce à la complicité d'une
équipe de démineurs commanditée par l'ONU.
Un militaire suédois
rencontré dans un bar de l'armée américaine à Islamabad nous avait mis sur la
piste. «Il y a des soldats canadiens qui enseignent aux Afghans l'art de
déminer le sol. Vous les trouverez au camp de Risalpour, en banlieue de
Peshawar. Ils ne peuvent aller mettre à profit leur savoir en Afghanistan, car
cela constituerait un acte de guerre. Ils sélectionnent les meilleurs éléments
parmi les réfugiés, et l'ONU, par l'intermédiaire de l'opération Salaam,
finance les travaux sur le terrain. »
Partis de Peshawar, au
Pakistan, nous avons traversé les zones tribales de Mohmand et Bajaur où
transitent l'héroïne, le haschisch et les armes sortant des fabriques artisanales.
Un gouverneur de district nous oblige à prendre une escorte armée, un garçon
mal lavé qui s'assoit sur la banquette avant en laissant son arme pointée vers
l'arrière, directement sur la personne de Jean- Pierre. La banquette est une
boîte de sardines et le photographe, incapable de se tasser, écarte
délicatement du bout des doigts le canon menaçant, mais rien n'y fait, la
carabine revient toujours à sa position initiale, comme mue par un ressort.
Quand le petit soldat nous a quittés en demandant un bakchich, notre chauffeur,
monsieur Saboor, comptable des programmes de déminage en Afghanistan et homme
de bonne carrure de son état, l'a menacé d'un coup de pied au cul.
Nous sommes entrés en Afghanistan
par le col de Nawa, le même qui, raconte-t-on, a vu passer les armées
d'Alexandre le Grand de Macédoine, en 325 avant ]ésus-Christ.
Les Russes avaient laissé
derrière eux des milliers d'épaves d'hélicoptères et de chars d'assaut, un
nombre indéterminé - entre 5 et 30 millions - de mines antipersonnel et
antichars, et un pouvoir fantoche, celui de Najibullah, dont les jours étaient
comptés. Sur la route de
Shinkolak, le village que
nos hôtes allaient déminer, il n'était pas question de descendre du pick-up
pour visiter un fortin éventré ou se dégourdir les jambes, la route étant
elle-même un étroit couloir déminé!
Les nuits afghanes étaient
si douces que nous dormions à la belle étoile sur des grabats tressés. C'était
d'un confort irréprochable, et nous ne nous formalisions pas d'une petite
ondée, toujours tiède et trop courte. Ce dortoir à ciel ouvert, compris entre
trois longs murets de torchis et la rivière, occupait une scierie équipée de
machines tchécoslovaques qui n'avaient rien scié depuis presque 12 ans.
Les délicates opérations de
déminage se faisaient entre six heures et midi dans le village abandonné de
Shinkolak, 33 km plus au nord.
Pas un chien qui aboyait,
pas un chat, pas même un rat; une vache qui eût brouté ici aurait fini par
voler en éclats, car le bourg était miné. Une mine antipersonnel venait tout
juste d'être débusquée dans ce qui avait été autrefois le bureau de poste. Les
experts s'apprêtaient à éliminer la bombe en faisant exploser, tout à côté, une
charge de dynamite.
JP jouait avec ses objectifs
à baïonnette et ses boîtiers, excité d'avoir de si incroyables photos à faire.
Soudain, il constate que le grand-angle dont il a besoin est sur le siège du
pick-up, à l'autre bout du village. Il nous avise brièvement: «Ne commencez
pas sans moi, je vais chercher un objectif. » Et avant qu'on ait pu lui répondre, il traverse à la
course le champ qui s'étale devant nous. Le voyant faire, nos amis moudjahidine
se mettent à hurler, à lui dire de ne pas courir. Mais rien n'y fait, JP
traverse le terrain en quelques secondes en suivant scrupuleusement le sentier
délimité par deux rangées de cailloux qui vont en slalomant au gré d'un
invisible caprice.
Il revient aussi vite, avec
l'objectif en question. Les Afghans sont blancs, sidérés. «Sir, you must not
run there! »
Je suis un coureur
expérimenté, je ne vais pas tomber en faisant ça ... » Mais les démineurs
insistent: «Sir, you must not 1 »
JP n'y a plus repensé.
Quinze ans plus tard, nous parlions de cet épisode et je lui ai appris, en
ayant toujours pensé qu'il le savait, que le danger qu'il avait couru ce jour
là avait été de faire exploser une mine antipersonnel par simple vibration.
Au-delà des cailloux du sentier, il n'y avait pas eu nettoyage des mines, pas
de quadrillage systématique. Dans sa course, il pouvait à tout moment poser
le pied à quelques centimètres d'un engin qu'une toute petite vibration,
équivalente aux pas d'un enfant, pouvait déclencher.
Câline de nono 1
L'horreur de ces sales et
minuscules choses échappe à l'entendement de ceux qui ne vivent pas en
territoire de guerre. La mine antipersonnel ne tue pas, elle blesse gravement,
mutile et devient du coup une arme très efficace pendant un affrontement, car
le blessé requiert l'aide de ceux qui combattent à ses côtés. Alors qu'un mort
...
Ouf!
Après le travail, nous
revenions au camp pour le déjeuner. L'après-midi, sous la chaleur accablante,
c'était la sieste. La journée se terminait ensuite dans de longues
conversations, des matches de foot ou la lecture du Coran, sans oublier les
prières. À la brunante, une génératrice
permettait d'éclairer le camp. On éteignait tôt, car il fallait se lever à
quatre heures du matin.
Malgré ses assises
sommaires, le camp permettait une certaine sécurité. La nuit, pendant que
dormaient les artificiers du général Kefayatullah - chef de l'opération Salaam
-, d'autres, armés de kalachnikovs, montaient la garde.
La région restait dangereuse
depuis la fin de l'occupation même si les « partis politiques» qui entretenaient
des
« bureaux » dans la vallée
cohabitaient dans une paix relative. La Jamiat-i-Islami de Massoud, le
Hizb-i-Islami de Gulbuddin Hekmatyar, la Salaffya réformiste branchée sur les
Saoudiens ainsi que notre unité de déminage aux couleurs officielles de l'ONU
devaient toujours craindre l'humeur du voisin ou de quelque bande de
maquisards.
Au nord-est de Kaboul, ces
factions composaient un paysage politique en apparence quasi désert dans un décor
aride. Les collines et les vallées de l’Afghanistan, disait-on, abritaient au
bas mot 800 factions, partis ou groupuscules. Tous armés. Et désunis.
Des tirs d'artillerie
retentissaient, le soir, alors que nous tentions de fermer l'œil.
«Qu'est-ce que c'est? Ai-je
demandé au docteur Suliman, notre interprète.
- Ce sont des moudjahidine qui s'entraînent au combat. Jean-Pierre a eu
la même réaction que moi: «Nous voulons les rencontrer.
- Pas question. Ce sont des
fanatiques. Ils sont entraînés par les Saoudiens. Ils vous tueraient.
- Les Saoudiens?
- Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent et ils aident
certains groupes extrémistes. Cet endroit est très dangereux, même pour
nous. »
Il nous aura fallu onze ans
avant de comprendre que nous avions probablement côtoyé pendant quelques jours
un camp d'entraînement financé et dirigé par Oussama ben Laden.
Nos accointances dans la
région nous avaient permis de constater que ces exaltés, peut-être des
terroristes à l'en~ traînement, n'avaient pas la sympathie des moudjahidine.
Une telle attitude, de la part de groupes armés jusqu'aux dents, avait de quoi
faire réfléchir et laissait supposer qu'une folie meurtrière animait les camps
sous influence saoudienne.
Les Russes avaient laissé
Najibullah au pouvoir à Kaboul, auréolé d'une indéniable modernité. Les femmes des
villes craignaient de devoir remettre le voile lorsque le régime serait
renversé, ce qui ne pouvait beaucoup tarder. Et le nom des talibans n'était
pas encore sur les lèvres en Occident. Dans les campagnes, comme ici dans le
Kunar, les femmes se cachaient, n'ayant même plus de champs à biner, les
enfants recevaient leur kalachnikov dès que leurs petits bras pouvaient tenir
cette arme redoutable, ici et là les épaves des Russes hurlaient à qui voulait
l'entendre que la technologie de guerre avait été incapable de traverser les
siècles pour vaincre le Moyen Âge.
DES CLIENTS À 8201 m
TEXTE INÉDIT. C'est arrivé
précisément le 26 septembre 2005. Mais bon, je ne veux pas résumer ça trop
bêtement. ..
L'échappée belle - il serait
temps d'en parler 1 - est une petite mais
très spéciale agence québécoise qui vend des voyages d'aventure et de montagne
à l'échelle de la planète. Le siège social de la multinationale a dû déménager
de Gaspé à Montréal, sans quoi le président de la société aurait été obligé de
s'acheter un hélicoptère avec chauffeur pour pouvoir continuer d'assurer avec
efficacité l'intendance de ses affaires.
L'entreprise est tellement
petite qu'elle tiendrait tout entière au sommet de l'Everest qui est - comme
tout un chacun sait puisque tout le monde y est allé - grand comme un 5 c.
Il faut dire que son
président, Jean-Pierre Danvoye, en est aussi le directeur général, le
secrétaire, la secrétaire, le chef de la direction, le chauffeur, le go-for, l'homme à tout faire, le
mécanicien, la couturière, l'entraîneur, l'accompagnateur, l'infirmier, le
cuisinier, le sommelier et le guide de haute montagne.
En mettant sur pied son
entreprise, JP a d'abord cherché, comme il se doit, un slogan efficace et il a
trouvé: «Le client a toujours raison. » Mais il ne l'a montré à personne. Il s'est contenté d'appliquer la
formule.
Malgré un effectif très,
très réduit, les destinations de L'échappée belle sont plutôt nombreuses et ont
toutes en commun de comporter une belle et généralement haute montagne et, tout
autour, une destination dépaysante et agréable. Et, à chaque petit déjeuner, en
altitude comme au camp de base, des délices en provenance de la pâtisserie De
Gascogne accompagnés du meilleur expresso. Les repas sont de calibre
gastronomique et s'arrosent de vins millésimés minutieusement choisis. Bref, on
a sorti Danvoye de la Belgique, mais on n'a pas sorti la Belgique de Danvoye
...
Aconcagua, Elbrouz, Ama
Dablam, McKinley, Kilimandjaro, Kala Pattar, camps de bas~ de l'Everest et du
K2, mont Washington et rebelote, chaque voyage étant préparé à la carte, en
fonction de la demande, il a fallu remettre ça, parce qu'une telle, son cousin
voulait aussi essayer, parce qu'un autre voulait aller ailleurs et plus haut,
parce que ces choses-là, on y prend goût. Petits groupes de six ou sept
clients, des fois moins, parfois juste deux.
Faut juste être capable de payer. Et de respirer dans l'air mince de la haute altitude. Parce que, détail supplémentaire, le client type de L'échappée belle est dans une forme athlétique. Les moumounes vont shopper ailleurs ...
Et
parce que les clients sont comme ils sont et que les graphiques de l'entreprise
montent toujours, comme sur les meilleurs parquets de la Bourse, ce qui un jour
devait arriver est arrivé le 26 septembre 2005 : deux clients et le boss lui-même sont parvenus au sommet du
Cho Oyu, 8201 m, sixième plus haut sommet du monde. «En prenant des petites puffs d'oxygène à l'approche du sommet,
juste pour assurer le minimum, sans exagérer. »
Du coup, Danvoye signait une page d'histoire double.
Une page de l'histoire québécoise de la montagne et une page de
l'histoire du tourisme québécois. Car cette réussite, que le pdg insiste pour
ne pas qualifier d'exploit, était la toute première d'une expédition commerciale
entièrement québécoise sur un sommet de plus de 8000 m.
«Je veux montrer qu'il y a
des 8000 mètres vraiment très accessibles au commun des vivants», dit-il dans
un élan de démocratie alpine. De son succès au Cho Oyu, il ne retient que
l'essentiel de la gloire: des gens ordinaires ont «fait» un des 14 sommets mythiques de la
planète. «Le Cho Oyu est un 8000 m facile, sans aucune dimension technique. Il
n'est pas nécessaire d'être un bon alpiniste pour parvenir au sommet; il faut
seulement être en forme et pouvoir séjourner dans les hauteurs. »
Alors devinez ... il lui a
fallu remettre au programme une autre ascension du Cho Oyu. Il prévoit
d'ailleurs fêter ses 60 ans en plein là, peut-être même au sommet. On peut lui
souhaiter longue vie à l'adresse suivante: jpdanvoye@lechappeebelle.com.
En somme - ou en sommet, eh!
- L'échappée belle est un nom qui raconte un peu le personnage, toujours en
mouvement, toujours en fuite de ce qui est plat et fade, un beau nom qui donne
le goût de partir à sa suite, de courir et de monter.
Surtout un beau non à
l'ennui et un pied de nez à l'âge de la retraite.
Le destin de Jean-Pierre
Danvoye pourrait être de devenir la personne la plus âgée à atteindre le sommet
de 8850 m. «Mais pour ça, avoue-t-il, je vais devoir attendre. » Encore trop jeune, en effet.
Ce sera sans doute comme pour John Glenn, qui est retourné en orbite à 77 ans.
S'il est un homme en ce bas monde qui devrait pouvoir atteindre la cime de
l'Everest dans la huitantaine, ce sera Jean-Pierre Danvoye.
J'en fais même la prophétie.
De toute façon, JP, y a pas
une maison d'accueil qui va l'accepter! Maudit gigoteux, pas capable de rester
en place deux minutes.
Il ira donner des
conférences aux p'tits vieux, tiens, ça lui fera un job de centenaire itinérant 1
Exclu du parking
des grabataires, il pourra toujours se consoler en se disant qu'il l'a échappé
belle!